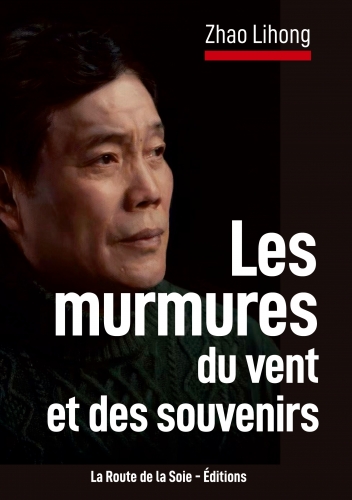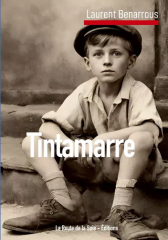Zhao Lihong : le souffle d’une mémoire résistante
Dans un monde où la vitesse écrase la mémoire, Les murmures du vent et des souvenirs de Zhao Lihong vient rappeler que l’intime est politique. L’auteur chinois, poète majeur de la scène littéraire contemporaine, livre ici une œuvre d’une rare humanité, tissée dans les fibres les plus sensibles de l’histoire. Ce n’est pas une autobiographie, c’est un sismographe. Un livre qui tremble sous les secousses du XXe siècle chinois, tout en refusant de hurler avec les loups.
Zhao Lihong choisit une posture douce, presque effacée. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Cette retenue est une forme de résistance. Par le style, par la structure, par les silences surtout. Il ne dénonce pas frontalement. Il témoigne. Il donne à voir. Il suggère l’ombre dans la lumière. Dans les interstices de ses souvenirs, se lit une chronique des blessures collectives — la Révolution culturelle, la pauvreté endémique, l’humiliation sociale, l’arbitraire du pouvoir. Mais toujours, à hauteur d’enfant ou d’adolescent. Comme si le regard pur, naïf parfois, permettait de dire ce que l’idéologie a broyé.
Loin de l’imagerie occidentale sur la Chine – soit misérabiliste, soit exotique, soit paranoïaque – Zhao Lihong donne chair à une Chine vécue. Une Chine intérieure, qui ne se résume ni à la croissance du PIB ni à la censure d’État. C’est cela qui dérange. Il n’entre pas dans les cases. Il n'est ni dissident spectaculaire, ni propagandiste servile. Il est un écrivain. Un vrai. Et cela, dans le monde de l’édition mondialisée, est devenu subversif.
La langue de Zhao Lihong (ici magnifiquement traduite) est simple, sensorielle, enracinée. Les paysages, les parfums, les gestes minuscules deviennent des lieux de mémoire. Il parle d’un cahier de poésie caché, d’un arbre, d’un enseignant humilié. Chaque détail devient politique. Parce qu’il résiste à l’oubli. Parce qu’il affirme : "nous avons vécu cela", sans surenchère, sans haine. La dignité du récit, dans un monde saturé de récits spectaculaires, est une arme.
Dans Les murmures du vent et des souvenirs, l’humanisme est frontal. Mais ce n’est pas celui des droits de l’homme abstraits. C’est celui du poète qui croit que la beauté peut encore dire la vérité. Une vérité feutrée, pudique, mais irréfutable. Le vent murmure, oui. Mais il n’est pas faible. Il sculpte la roche. Il érode l’oubli. Il traverse les générations.
Alors, face à cette œuvre, une question : pourquoi ces livres-là ne sont-ils pas au programme de nos lycées ? Pourquoi l’édition française continue-t-elle de publier des récits chinois formatés, sensationnalistes, quand elle pourrait faire découvrir ces murmures essentiels ? Peut-être parce que la mémoire, surtout quand elle vient d’ailleurs, fait peur. Parce qu’elle ouvre des brèches dans notre confort d’analyse, dans notre paresse critique.
Zhao Lihong ne nous dit pas quoi penser. Il nous oblige à penser.
Et cela, aujourd’hui, est un acte profondément politique.