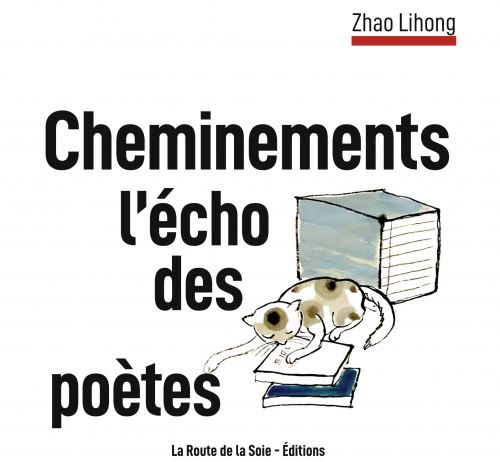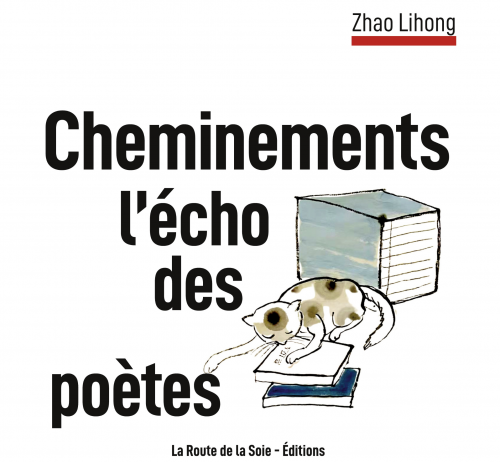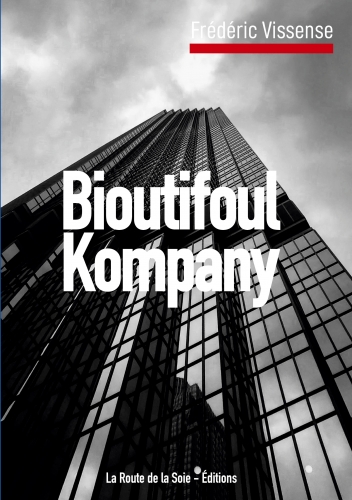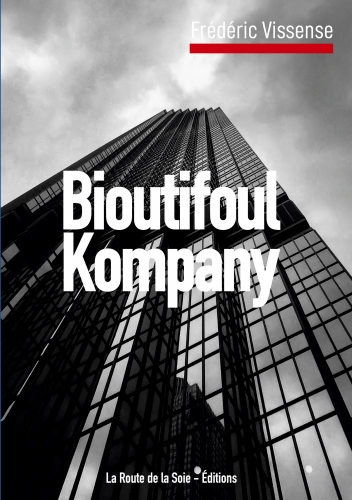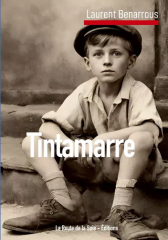Zhao Lihong : un poète en résistance lente
Avec Cheminements : l’écho des poètes, publié aux éditions La Route de la Soie, Zhao Lihong ne livre pas un simple recueil de poésie. Il propose un acte de résistance. Face à la brutalité du monde, à l'effacement des sensibilités, il choisit la lenteur, le regard oblique, le chant de l’intime. Un geste politique, à sa manière.
Dans un monde saturé de performances, d’algorithmes, de contenus à consommer plus vite qu’ils ne s’oublient, la poésie semble déplacée. Mieux : elle dérange. Parce qu’elle prend son temps, parce qu’elle invite à regarder autrement, à penser autrement. Zhao Lihong le sait. Et c’est précisément là qu’il creuse son sillon. Avec douceur, mais avec obstination.
Dans Cheminements, chaque texte, chaque image (car les illustrations sont aussi de sa main), propose une brèche. Non pas une échappatoire, mais une invitation à résister par la finesse, par l'attention, par le lien. Résister à l’arasement des cultures, à l’uniformisation des esprits, à l’oubli de la mémoire et des paysages intérieurs.
Ce livre est né d’un dialogue. D’un projet éditorial pensé comme un pont entre les cultures, entre les temporalités, entre les humanités. Il ne s’agit pas d’un hommage exotique à une poésie chinoise muséifiée. Il s’agit d’un compagnonnage. D’un acte de proximité. Après Métamorphose(s), ce nouvel opus pousse plus loin encore la démarche : il veut toucher, il veut rencontrer, il veut faire vibrer des cordes communes.
Mais ce qui frappe surtout, c’est la portée politique du geste poétique. Non pas au sens d’un discours revendicatif ou idéologique, mais dans sa capacité à faire exister ce qui est systématiquement écrasé : l’invisible, l’imperceptible, le fragile. En ce sens, Zhao Lihong est un poète infiltré. Il infiltre nos automatismes, il déjoue nos attentes, il réhabilite l’attention. Il nous oblige à nous redemander : que voyons-nous ? Que sentons-nous encore ? Que voulons-nous transmettre ?
Chaque page de ce livre oppose à la logique du marché une logique du sens. À l’accélération, une marche lente. À la communication, une communion. Ce n’est pas un hasard si le mot cheminement a été choisi : il contient l’idée d’un mouvement habité, d’un refus de l’instantané, d’un respect pour ce qui pousse lentement. Un mot qui, dans notre société de la vitesse, a presque disparu du langage courant.
Et puis il y a l’image. Car Zhao Lihong n’est pas seulement poète : il dessine, il peint. Ses aquarelles accompagnent les textes comme des présences muettes, des méditations visuelles. Là aussi, rien de spectaculaire. Juste une main, un trait, une ombre. Mais tout est là : une humanité qui résiste au bruit par la simplicité.
Lire ce livre, c’est accepter de se laisser traverser. C’est se désarmer. Et dans ce désarmement, retrouver un souffle. Une mémoire. Une capacité d’émerveillement.
À l’heure où l’on tente de nous faire croire que tout doit être utile, rentable, efficace, Cheminements vient rappeler que ce qui sauve — vraiment — échappe à toute logique comptable. Ce livre est inutile, au sens noble du terme. Il est nécessaire.
Un acte de beauté comme acte politique.